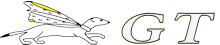LE BRAS Anatole - Aliénés
| Titre : | Aliénés - Une histoire sociale de la folie au XIXe siècle | ||
| Auteur : | LE BRAS Anatole | Type : | Livre/Brochure |
| Edition : | CNRS Editions | Note : | - |
| Impression : | Paris | Année : | 2024 |
| Pages : | 7 | Référence : | ISBN 2271144676 |
Autres lectures : « Espace Déguignet » ¤ « La folie hospitalière selon Jean-Marie Déguignet » ¤ « Les séjours et décès de Jean-Marie Déguignet à l'hospice de Quimper » ¤ « CARRER Philippe - Ethnopsychiatrie en Bretagne » ¤
À une lettre finale près, le nom-prénom de l'auteur du livre "Aliénés" publié en 2024 aux Editions du CNRS renvoie à un autre mémorialiste breton, l'auteur des légendes de la mort et premier éditeur des mémoires de Déguignet en 1905.
L'agrégé et docteur en histoire Anatole Le Bras (et non Braz comme son presque homonyme) a rassemblé ses recherches au croisement de l'histoire sociale et de l'histoire de la psychiatrie au XIXe siècle en se basant sur des trajectoires d'individus internés à l'asile Saint-Athanase de Quimper, l'hospice pour femmes de Morlaix et la Maison de santé de Ville-Évrard.
L'ouvrage est émaillé de statistiques, de remises en contexte des lois et politiques sociales, et surtout de nombreux témoignages d'internés et de soignants. Le patient Déguignet, qui a séjourné dans l'établissement de Quimper entre 1902 et 1905, est cité brièvement pour son appréciation du gîte et du couvert dont il bénéficie en tant qu'indigent : « Pour moi, je n’ai jamais été si bien logé, ni mieux nourri de ma vie ».
Les mémoires de Déguignet sur sa fin de vie d'aliéné à l'hôpital au début de XXe siècle pourraient très bien illustrer encore le constat d'Anatole Le Bras : « La notion de dangerosité est suffisamment labile pour permettre d’agréger au domaine de la folie une grande diversité de tares, de pathologies et de déviances, mais aussi de formes de vulnérabilité ».
Le gîte et le couvert selon Déguignet :
Le régime alimentaire des Finistériens, en particulier ruraux, se caractérise encore au début du XXe siècle par sa frugalité et ses carences{1042} ; il n’est donc pas invraisemblable que des internés, même placés au régime commun, aient pu juger la nourriture de l’asile satisfaisante {1043}
Note 1043 : « Pour moi, je n’ai jamais été si bien logé, ni mieux nourri de ma vie », dit Jean-Marie Déguignet au moment de son admission à l’hospice civil de Quimper en 1902, alors qu’il vit dans la misère. Jean-Marie Déguignet, Histoire de ma vie. Texte intégral des mémoires d’un paysan bas-breton, 2e édition, Le Relecq-Kerhuon, An Here, p. 725.
Conclusions :
« On est aliéné ou on ne l’est pas ». La formule de Montalivet lors des discussions sur la loi de 1838, faisant appel à un certain sens commun (il y a ceux qui sont fous et ceux qui ne le sont pas), se traduit par un dispositif d’assistance aux aliénés qui ne connaît guère de demi-mesure. La prise en charge est uniforme et intégrale. Elle est assurée par une institution unique – l’asile – et n’admet, du moins en théorie, pas d’alternative. L’hostilité à l’hôpital, la crainte de dénouer les solidarités familiales, si vives pour d’autres catégories de déshérités, sont mises de côté pour promouvoir le « tout-à-l’asile » et se prémunir ainsi du péril multiforme de l’aliénation mentale.
Si ce caractère dichotomique de la loi semble au départ la destiner à n’être qu’un dispositif atteignant les formes les plus spectaculaires et les plus dangereuses de la folie, le caractère englobant de l’aliénation mentale en permet néanmoins rapidement une application étendue. La notion de dangerosité est suffisamment labile pour permettre d’agréger au domaine de la folie une grande diversité de tares, de pathologies et de déviances, mais aussi de formes de vulnérabilité. L’internement s’impose comme un efficace moyen de régulation infrajudiciaire. Sa procédure consacre une définition sociale de la folie : est aliéné celui que les familles, le voisinage, les autorités locales, la police ou la gendarmerie considèrent comme tel.
[...]
Le séjour à l’asile, ce mode de traitement en apparence uniforme, ne produit pas les mêmes effets sur tous. Il accentue l’isolement de ceux qui sont déjà isolés et fragilise la position de ceux qui sont déjà fragiles.