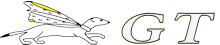Espaces de noms
Inventaire des fours gabéricois, fonds Le Guiriec AMQ
(Redirection)

Descriptions techniques, mesures et caractérisques, photos de 13 fours à pain implantés sur la commune d'Ergué-Gabéric.

Source : Classeur conservé aux Archives Municipales de Quimper sous la cote 55 J 14.
Autres lectures : « Panorama des anciens fours à pain gabéricois » ¤ « Restauration du four à pain de Kerfres, Le Télégramme 2009 » ¤ « 1728 - Inhumation hors des lieux saints suite à une mort tragique dans un four à pain » ¤ « LE GUIRIEC Pierre - Fours en granit en Basse Bretagne » ¤
Présentation
En tant que professionnel de l'industrie boulangère, Pierre Le Guiriec s'est consacré pendant de longues années à la découverte des anciens fours à pain de nos campagnes. Après avoir recensé près de 1 000 fours à pain en Basse-Cournouaille, il a publié en 2012 un livre intitulé « Fours en granit et pains de campagne en Basse-Bretagne ».
Dans ce livre sont cités deux fours gabéricois, l'un à Kerrous, l'autre à Creac'h-Ergué. Mais il en connaît précisément d'autres, car entre 2006 et 2012 il a pu visité nos antiques fours à pain dispersés sur tout le territoire communal. Il en a fait des fiches et pris des photos lors de ses visites, et le résultat de ses observations a été versé aux Archives municipales de Quimper (cote 55 J 14).
Au total 13 fours différents, adossés ou non à un « ti-forn » (maison du four), avec pour chacun la description de leur état, les mesures de leur profondeur utile, du diamètre et hauteur sous voûte, de l'ouverture (de plein cintre ou non), de l'écartement entre les deux montants droits. Les tirages papier de ses photos argentiques sont également joints, à raison de quatre regroupées sur pages A4.
Le style rédactionnel est presque poétique, ainsi l'édifice de Kerdalès visité en mars 2008 : « Le four est en très bon état malgré les apparences, avec sa petite hotte classique sur une ouverture de plein-cintre, des montants droits et une petite table d'autel comportant une fente à l'avant en guise de trou à cendres et deux corbeaux taillés en doucine. »
Pierre Le Guiriec note aussi quelques anecdotes de vie locale, ainsi à Meilh-poul où le four est attenant au moulin : « afin de livrer ses clients lui ayant confié des céréales à moudre, le meunier attelait sa jument à une charrette où s'entassaient les sacs de mélanges. Soucieux de ménager ses vieilles jambes fatiguées par l'âge, il coupait au plus droit dans le bois à chaque lacet du chemin, laissant la jument continuer seule et sans guide. »
En février 2009 il est à Kerfrès où règne une grande effervescence autour du four local reconstruit entièrement, avec une assistance nombreuse venue fêter « la cuisson de la fournée inaugurale et humer la bonne odeur du pain chaud, divertissement tout à fait inhabituel qui aura fait la joie de nombreux enfants du quartier ».
C'est l'occasion de retourner sur les lieux en octobre 2025 et de filmer le bel ouvrage en en faisant le tour :
Fiches, photos et transcriptions
Transcriptions des fiches :
Four du moulin de Meilh-Poul (au lieu-dit Le Stangala ou Stang-Odet)
L'accès à cet ancien moulin construit sur les berges de l'Odet rupestre empruntait autrefois un vieux pont en pierres (remplacé aujourd'hui par une passerelle) et le versant opposé sur le coteau d'Ergué-Gabéric. De cette bâtisse ne subsistent que des ruines et des pans de murs moussus, ainsi que l'emplacement de l'ancienne maison du four à pain, complètement délabrée sous les assauts des crues hivernales, pourtant tout ceci vivait encore jusqu'aux années 1950.
Site enchanteur, les gorges du Stangala sont très prisées en été par les randonneurs en quête de fraîcheur et de calme. L'hiver, quand l'eau dévale entre ces deux berges parsemées de blocs rocheux et d'éboulis en un gros bouillon continu vers Quimper, il se crée une résonance qui accentue la sensation quelque peu oppressante et mythique de l'endroit.
Du côté de Kerfeunteun, l'accès très sportif emprunte une descente boisée, formée d'un chemin raviné et très pentu qui serpente jusqu'à la rivière au gré de sa fantaisie.
Un cultivateur voisin s'afférant à fendre du bois de chauffage sur le plateau me raconte cette amusante anecdote concernant le dernier meunier en exercice au moulin. Il y a toujours de belles histoires autour des moulins et notre meunier, afin de livrer ses clients lui ayant confié des céréales à moudre, attelait sa jument à une charrette où s'entassaient les sacs de mélanges. Soucieux de ménager ses vieilles jambes fatiguées par l'âge, il coupait au plus droit dans le bois à chaque lacet du chemin, laissant la jument continuer seule et sans guide. Quoi de plus naturel me direz-vous, sauf pour certains virages, plus accentués que d'autres, exigeant une délicate manœuvre de marche arrière, que le cheval, très intelligent, exécutait facilement, uniquement guidé à distance par le sifflement du meunier ...
Comme bien souvent en ces endroits à l'abandon, le végétal engloutit le minéral, mais toujours le four résiste aux intempéries. Il s'agit ici d'un four adossé de belles dimensions dont la voûte en chapelle, très solide encore, repose sur deux rangs de blocs en granit taillé, d'une hauteur de 0,33 m, disposés en claveau bien régulier. Seules les dalles de la sole se sont disloquées sous l'effet des crues qui s'avancent jusqu'au niveau de l'autel pourtant surélevé.
La façade bien équilibrée a conservé ses deux corbeaux de cheminée, mais le linteau a disparu dans le chaos de pierres entassées pêle-mêle dans ce qui reste du ti-forn généralement inondé. Le dôme herbeux est envahi par les ronces et les fougères, mais fort heureusement aucun arbre ne s'y est installé pour le moment.
Des promeneurs présents lors de ma visite n'en croyaient pas leurs yeux en découvrant cet édifice, quelque peu masqué il est vrai. Ils connaissaient pourtant bien l'endroit, mais n'avaient jamais supposé qu'il puisse exister là un si beau four à pain toujours debout.
Dimensions du four :
- profondeur utile : 2,40 m ; diamètre : 2,20 m ; hauteur sous voûte : 1,20 m (estimation) ;
- ouverture de plein cintre : 0,70 m à la base sur 0,62 m de haut ;
- écartement entre les deux montants droits : 0,95 m.
Four au manoir de Pennarun (adossé à l'origine à un ti-forn)
À l'emplacement de ce manoir construit dans les années 1765 existait, semble-t-il, un château bien plus important dont les souches nobiliaires successives se retrouvent dans les côtes d'Armor au sein de la commune de Lantic et le domaine de Bourgogne.
Propriété des Geslin de Pennarun jusqu'à la Révolution, cette bâtisse est ensuite vendue comme bien national et transformée, comme la plupart des demeures de petite noblesse, en exploitation agricole.
Jusqu'à une période très récente, la famille Lozach y développera une activité cidricole fort réputée et participera activement à l'obtention de l'appellation d'origine contrôlée « cidre de Cornouaille ».
Le chemin d'accès à la cour mène droit au cul du bâti et de sa masse sombre qui en impose par sa maçonnerie bien d'aplomb et toujours solide sur de gros blocs en granit.
Les vestiges d'un mur gouttereau à droite de la façade et d'une banquette de commodité dans l'encoignure attestent de son origine de four adossé et seule une petite partie du mur-pignon retient la couverture herbeuse du dôme.
Une restauration d'allure peu orthodoxe est intervenue sur la voûte et son couronnement en chapelle sur une assise pourtant très solide à la base avec une rive toute en blocs taillés régulièrement.
Comme dans la majorité de nos maisons noble, la cuisine abrite un petit four d'office en angle et contigu à une grande cheminée dont le linteau a été malheureusement massacré.
La façade est très coquette avec sa hotte intégrée dans le mur, le conduit d'évacuation des fumées rejoignant celui de la grande cheminée voisine de la même manière.
Sur les trois blocs formant l'ouverture de plein cintre est prévue une feuillure afin de recevoir une porte en encastrement. La petite table d'autel fort joliment ouvragée au dessus d'une niche au sol pour la réserve de bois, ajoute une touche d'originalité dans cette pièce plutôt austère.
Dimensions du four :
- profondeur utile : 2,25 m ; diamètre et hauteur sous voûte non mesurés ;
- ouverture de plein cintre : 0,65 m à la base sur 0,62 m de haut ;
- écartement entre les deux montants droits : 1,00 m ;
- profondeur de la table d'autel : 0,25 m ;
- petit trou d'office : 0,90 m 0,70 m de diamètre, sa forme est celle d'un U inversé et la voûte est constituée de petites briquettes réfractaire bien érodées signe d'une utilisation intense.
Four de Kervreyen (adossé)
Pour rejoindre cette ancienne ferme, le chemin défile devant le coquet manoir de Kernaou, propriété dont dépend l'ancien four à pain. Ce manoir typiquement breton présente sur l'angle de sa façade droite une échauguette ou bretèche, il daterait, selon mes informations, du 15e ou du 16e siècle.
La ferme elle-même est à l'évidence très ancienne, si l'on se réfère à l'usure de la pierre de seuil du logis principal surmonté d'une superbe accolade sculptée au bon linteau, ainsi qu'au bel appareillage des pierre de taille ancienne en façade, mais pas de date apparente.
Ces observations permettent cependant de cerner la date de construction du four monumental aux alentours du 17e ou du 18e siècle. Il faut cependant prendre en considération que certains édifices, après des années d'utilisation, avaient besoin de réparations notamment au niveau de la voûte.
Ce four isolé s'élève dans la très large allée menant directement au courtil. La partie droite du bâti s'est écroulée, alors que la chambre de cuisson et sa voûte sont pour le moment intacts, mais en sursis, si rien n'est entrepris pour reconsolider la maçonnerie qui souffre par manque de soins.
Il s'agit là d'un patrimoine précieux qu'il faudrait préserver absolument et le présenter comme tel doit être un début de prise de conscience.
Dimensions du four :
- profondeur utile : 2,30 m ; diamètre : 2,20 m ; hauteur sous voûte : 1,35 m ;
- ouverture de plein cintre : 0,65 m à la base sur 0,65 m de haut ;
- la voûte repose en rive sur douze blocs en granit de 0,33 m de haut, de 0,30 m en seconde couronne, puis de 0,25 m en dégressif jusqu'à la clef de voûte ;
- écartement entre les deux montants droits : 1,10 m ;
- profondeur de la table d'autel : 0,30 m ;
- présence d'une fente d'évacuation des cendres sur l'avant du bloc autel avec niche de réception quelque peu enfouie sous le terreau de feuilles.
Four de Beg ar Menez (Isolé)
Construit à l'angle de deux talus aux abords de l'ancienne aire à battre les moissons, le bâti de ce four est judicieusement soutenu par ces deux constructions en pierres sèches couvertes de terre et longées par un chemin charretier.
La façade fait face aux très beaux bâtiments de l'ancienne ferme rénovée. Ils abritaient, outre la maison d'habitation, la laiterie, la crèche et l'écurie pour les chevaux, le tout sur une enfilade très basse de près de quarante mètres de long.
La surprenante façade est dotée de deux corbelets, eux-mêmes surmontés à l'origine par deux autres pierres saillantes vers un fronton qui se perd dans un fouillis de verdure, celle de droite a disparu, victime d'un coup de fourche de tracteur.
La chambre de cuisson est ici utilisée pour des parties de barbecue fort sympathiques mais ces petites flambées éphémères ont eu pour effet de noircir totalement l'intérieur que seule une chauffe bien franche parviendra à éliminer.
Il s'agit de l'un des rares fours isolés de la commune et de ce fait sa préservation est précieuse pour le patrimoine local, déjà très riche comme l'a si bien souligné mon ami Pierre Faucher, auteur d'une monographie très intéressante sur la commune (1).
Passionné par l'élevage et le dressage de chevaux de trait bretons, mon hôte, très imprégné de culture terrienne, est bien conscient que la préservation de cet édifice est importante et il fera l'impossible pour l'entretenir dans cet esprit de ruralité qui lui est cher.
Dimensions du four :
- profondeur utile : 1,90 m ; diamètre et hauteur sous voûte : non mesurés ;
- ouverture de plein cintre : 0,58 m à la base ; 0,54 m de haut ;
- écartement entre les montants droits : 0,82 m ;
- profondeur de la table d'autel : 0,25 m ;
- pourtour total du bâti : 13,60 m.
Four adossé n° 1 à Quillihouarn (17e – 18e siècles)
Trois fermes étaient exploitées dans ce hameau autrefois, entourées de quelques penn-ti, aujourd'hui joliment rénovés et transformés en résidences permanentes.
Des traces très anciennes de présence humaine se retrouvent sur des linteaux à accolades, dont l'un décoré d'une fleur de lys sculptée en relief, des ouvertures à l'embrasure très étroites ainsi qu'un auge de plus de deux mètres de long avec inscription impressionnante.
Posé sur une aire gazonnée, ce four donne une impression de grande solidité par ses gros blocs en pourriou, couronné jusqu'au dôme herbeux. La présence de deux murs latéraux en façade, vestige d'un pignon à l'origine, confirme qu'il s'agissait bien d'un four adossé.
Un proche voisin m'affirme avoir connu le ti-forn encore couvert d'un toit de genêt, matériau qui était fréquemment utilisé en appoint à la paille de seigle et au chaume sur les étables, porcheries ou lohchou (baraques ou cabanes).
Compte-tenu de sa grande surface de cuisson, ce four était utilisé en communauté, d'autant que ce hameau très peuplé comptait de nombreux foyers alentour. La voûte semble excessivement haute, mais elle est de forme plutôt conique, ce qui amplifie la première impression.
Les blocs sont disposés en couronnes régulières bien étagées jusqu'à la clef et la voûte qui semble bien étanche. Seules les dalles de la sole se sont affaissées en leur centre comme souvent, faute de soutien de la partie inférieure composée essentiellement de terre qui se tasse et se réduit après les chauffes successives.
Le cintre de l'ouverture, bien érodé par l'attaque de flammes, est brisé, mais l'état général est par ailleurs très satisfaisant et représente un beau patrimoine à préserver.
Dimensions du four :
- profondeur utile : 2,40 m ; diamètre : 2,20 m ; hauteur sous voûte mesurée à la clef : 1,40 m ;
- ouverture à l'origine de plein cintre : 0,68 m à la base pour 0,70 m de haut ;
- écartement entre les montants droits : 1,40 m ;
- profondeur de la table d'autel : 0,50 m ; bloc autel : 1,65 m hors-tout pour une épaisseur de 0,25 m ;
- présence de deux niches de rangement très décoratives au niveau des corbeaux taillés en
Four adossé n° 2 à Quillihouarn
Très proche du premier four, celui-ci s'adosse au pignon d'une longère en cours de rénovation, mais le bâti s'est littéralement effondré à l'arrière suite à l'élimination d'un vilaine souche qui s'était incrustée sur le dôme.
Le jeune et nouveau propriétaire des lieux envisage très sérieusement de le réhabiliter, d'autant que pour des raisons non connues, la façade avait été masquée à l'intérieur de la longère par une cloison.
À une certaine époque, curieusement, il semblerait que ce four ai connu une utilisation pour le moins inhabituelle et peu banale. Après quelques aménagements à l'intérieur de la chambre de cuisson, ce four a servi pour cuire de la poterie, comme en témoigne la présence de nombreux fragments divers provenant de vases, pichets et goulots en terre blanche enfouis au pied du bâti extérieur. De nombreuses pièces de monnaies à l'effigie de Napoléon Empereur ont également été découvertes, avec sur l'autre face l'aigle aux ailes déployées que l'on connaît.
Fours de Kerdales (adossés)
Implantés de part et d'autre du chemin vicinal, deux fermes se côtoyaient ici autrefois et seule l'une d'entre elles, spécialisée dans la production laitière, conserve une activité agricole dans ce hameau.
L'accueil très chaleureux qui m'est réservé m'encourage à la découverte de nombreux bâtiments répartis de part et d'autre du chemin et délaissés pour les raisons de nous connaissons. Ils abritaient encore au début du siècle dernier plus de 30 personnes pour quatre foyers comprenant domestiques et exploitants, travaillant à l'aide de chevaux avant l'arrivée de la modernité et des tracteurs.
La « vieille » maison datant du 18e siècle présente sur sa façade un mur maçonné en granite et schistes offrant un bel appareillage de couleurs intercalées en marqueterie claire et sombre.
Sitôt le seuil franchi sous l'accolade, le couloir d'entrée cloisonné en terre battue, puis sur la droite, la grande pièce commune très encombrée où mon regard est aussitôt attiré vers l'immense cheminée se dressant dans la pénombre avec sa niche à cendres derrière un grand fait-tout abandonné là sur son trépied.
Partout, de nombreux objets de la vie quotidienne qui semblent figés dans l'attente d'un retour improbable. Sensation qui suspend momentanément le temps et voit défiler toute une vie, comme une invite à vous asseoir un moment sur le rebord de l'âtre pour se souvenir.
Un petit banc à trois pieds servant pour la traite, une grand bahut éventré laissant entrevoir des ustensiles devenus inutiles, un berceau avec ses petits barreaux tournés, un trépied encore appuyé sur une très grande galettière et ce harnais ou ces colliers pour les chevaux, soigneusement suspendus aux grosses poutres comme s'ils devaient resservir, conservés comme des reliques.
Puis, au dehors, ça et là sur les aires à battre, des vieilles machines aratoires branlantes et rouillées, faneuse, arracheuse de pommes de terre à brancard central et ses doigts articulés, vieux tarares ou encore faucheuse rappellent un temps où les foins, les blés, les labours rythmaient les saisons en nos campagnes. Devant le four adossé à un ti-forn, de gros foudres (1) pour le cidre, devenus encombrants et le petit maillet en bois servant à enfoncer les bondes.
Le bâti extérieur du four est recouvert par un roncier, mais ce sont surtout de jeunes frênes en périphérie qui inquiètent mon hôte qui connaît fort bien les diverses essences de bois. « Ceux-ci, me dit-il, ont une croissance rapide, mais surtout des racines qui s'installent très loin, parfois jusqu'à 15 ou 20 mètres, c'est un bois dur, mais élastique, dont on se servait pour la fabrication des arcs, des tonneaux, des montants d'échelles et de manches d'outils. »
Le four est en très bon état malgré les apparences, avec sa petite hotte classique sur une ouverture de plein-cintre, des montants droits et une petite table d'autel comportant une fente à l'avant en guise de trou à cendres et deux corbeaux taillés en doucine.
Un second four existait ici, vu l'importance du hameau, il n'en reste que la façade encore très belle et pratiquement identique à celle de son voisin.
Dimensions du four :
- profondeur utile : 2,20 m ; diamètre : 2,00 m ;
- ouverture : 0,55 m à la base sur 0,50 m de haut ;
- écartement entre les montants droits : 1,05 m ;
- profondeur de la table d'autel : 0,35 m ;
- linteau de cheminée : 1,40 m de long pour 0,40 m de haut.
Four au moulin de Kergonan (1) (isolé à fronton)
Un chemin qui serpente à travers bosquets et taillis et bientôt, au débouché d'une sapinière plutôt sombre, s'éclaire le fond de la vallée de l'Odet laissant entrevoir le bleu ardoise du moulin blotti en contrebas.
Seul dans le silence, le discret bruissement de l'eau, à la fois doux et confus, et vous êtes déjà conquis par la sérénité de l'endroit. Bientôt en surélévation surgit un jardin très coloré surmontant la cour elle-même, entourée de vastes pelouses à flanc de coteau.
En pleine contemplation, arrive mon hôte auquel je fais part de l'objet de ma visite : « Le four, me dit-il, mais il est là derrière vous ! » Toujours sous le charme, je ne l'avais même pas remarqué à l'entrée près d'un bosquet avec son ouverture très basse au sol et sa table d'autel semi-enterrée.
L'existence de ce moulin aujourd'hui restauré est stipulée dans un aveu de l'an 1532, année du vote des Etats de Bretagne pour le rattachement à la France. Il a conservé ses deux coffres et ses meules autrefois actionnées par une grande roue qui a disparu. Mais l'eau qui circule à l'intérieur même du moulin, sous une dérivation couverte par une paroi en verre, elle-même éclairée par des projecteurs, lui assure une particularité hors du commun.
Sur l'un des frontons des fenêtres du logis principal est gravée en lecture inversée la date de 1741, mais il s'agit d'une curiosité due au réemploi de cette pierre lors de la rénovation du bâtiment.
Comme dans tous les moulins, le four isolé avait pour principal usage le séchage du grain d'avoine. Cependant, il avait été également prévu pour d'autres usages car, compte-tenu de l'isolement de l'endroit, le meunier et sa famille, vivant pratiquement en autarcie, l'utilisait à plus forte raison pour cuire du pain, d'autant qu'en matière de farine il était généralement bien pourvu en matière première.
La façade est très dépouillée car seuls les blocs de l'encadrement de l'ouverture disposés tête-bêche et le bloc autel portent les traces d'une taille. Les dalles de la sole sont bien en place, la voûte, en revanche, s'est normalement affaissée en périphérie de la clef et elle n'est plus de ce fait arrondie en chapelle. L'explication se trouve à l'extérieur où trois chênes énormes ont poussé sur le dôme depuis de très nombreuses années et écrasent la voûte leur poids.
Dimensions du four :
- profondeur utile : 2,30 m ; diamètre : 2,45 m ; hauteur sous voûte ramenée à 0,90 m ;
- ouverture de plein cintre : 0,62 m à la base pour 0,55 m de haut) ;
- écartement entre les montants droits : 1,40 m ;
- profondeur de la table d'autel : 0,30 m ;
- la voûte repose en rive sur treize gros blocs de 0,40 m de hauteur et de longueurs diverses ;
- certaines pierres de la voûte présentent des arrondis laissant supposer qu'elles pourraient provenir du lit de la rivière toute proche, comme la plupart de celles formant le soutènement du jardin en surplomb.
(1) Les anciens prononcent Kergonn.
Four de Creach-Ergué
Ce très bel édifice est adossé à ce qui fut autrefois un Kaardi, puis une étable.
Selon mon témoin, ce four desservait deux fermes, mais le hameau est très important et il est vraisemblable qu'il servait également pour d'autres habitants du lieu.
Ce four est très bien conservé extérieurement, seule la souche de cheminée a été refaite en parpaings, ce qui dénature un peu l'ensemble.
Intérieurement, on retrouve une très belle façade en pierres de taille et une ouverture de plein cintre qui a conservé sa pierre de fermeture d'origine. La petite table d'autel est encastrée, mais très massive, le bloc s'est cependant fendu au dessus de la niche. Il n'y a pas de trou à cendres. On remarque deux très grandes dalles de granit en sole, dont deux se sont affaissées vers le centre. Dimensions du four :
- profondeur utile : 2,30 m ; diamètre : 2,15 m ; hauteur sous voûte : 1,20 m ;
- ouverture de plein cintre : 0,62 m à la base ; hauteur : 0,60 m de hauteur (composée de deux blocs debout) ;
- profondeur de la table d'autel : 0,35 m ; dimensions entre les montants droits : 1,05 m ;
- blocs de 0,33 m de haut en rives, puis deux rangs de 0,25 m, les premiers rangs partent à la verticale, le troisième est légèrement rentrant.
Four de Coat-Piriou (adossé)
Coat-Piriou se trouve sur le versant de la vallée de l'Odet et ce village d'anciennes fermettes bénéficie d'un environnement boisé et calme, mis en valeur par une rénovation réussie sur des petites longères basses et agréables à vivre.
Pour le petit ti-forn qui se présente dès l'entrée de la cour, les constructeurs ont judicieusement utilisé le plan pentu propice à l'assise du four et de son bâti très bas, aujourd'hui bien soutenu par une masse de terre en pourtour et qui le protège avantageusement.
Devenu réserve pour le bois de cheminée, le ti-forn abrite une façade typique au canton avec cependant une table d'autel très profonde entre des montants droits présentant des gros blocs bien assortis en angle pour un écartement d'une importance inhabituelle.
Le beau linteau en granit est soutenu par deux consoles finement taillées. L'ensemble manque cependant d'harmonie en raison d'un bloc autel peu uniforme. Mais cette façade bien abritée garde tout son intérêt patrimonial, malgré l'absence de niche réceptrice pour les cendres.
La chambre de cuisson présente une superbe voûte intacte et seul le plan de cuisson (dalles) semble s'être quelque peu affaissé, il pourrait être re-nivelé sans difficultés majeures. Dimensions du four :
- profondeur utile : 1,70 m ; diamètre et hauteur sous voûte : non mesurés ;
- ouverture de plein cintre : 0,60 m à la base ; hauteur : 0,56 m de haut ;
- écartement entre les montants droits : 1,68 m ;
- profondeur de la table d'autel : 0,58 m ;
- linteau : 2,10 m de long pour 0,35 m de haut.
Four de Kerfres (ancien four adossé du 17e siècle transformé en isolé)
Grande effervescence en ce 19 février, dans ce secteur rural de Squividan, pour assister à la cuisson de la fournée inaugurale et humer la bonne odeur du pain chaud, divertissement tout à fait inhabituel qui aura fait la joie de nombreux enfants du quartier.
Appartenant à la famille Rannou depuis 1804, après avoir été la propriété du Seigneur de la Marche, comme une grande partie des terres de ce secteur, le hameau comptait autrefois deux fermes, en contrebas du chemin.
Adossé à l'origine à un kaardi, le four, très à l'écart, n'était absolument pas mis en valeur. En mémoire de son défunt époux, la propriétaire ne voulait à aucun prix le voir disparaître comme elle me l'explique : « Nous disions toujours avec mon mari qu'il avait une belle devanture et qu'il serait intéressant de la remonter à l'entrée de la ferme. »
Les travaux de démolition et de reconstruction furent confiés à un artisan maçon de Pouldreuzic, spécialisé en maçonnerie ancienne et labellisé UCRPAB (1), sous l'égide de la Fondation de France. Ils ont été menés à bien pour tout ce qui concerne l'utilisation des matériaux et le respect de l'architecture locale qu'il fallait avant tout préserver.
Avec l'aide d'un artisan boulanger de Pouldreuzic pour la confection de la pâte et de votre serviteur pour la préparation progressive de la chauffe du four durant près de trois jours, nous avons, à la satisfaction générale, participé activement à la cuisson de près de 40 boules de vrai pain de campagne, uniquement au levain naturel comme il se doit pour ce genre de fête conviviale exceptionnelle.
La dégustation, accompagnée de pâté de campagne et autre graisse salée, a fait de cette belle initiative de Madame Rannou, qui souhaitait rassembler tout le quarter pour le pot de l'amitié comme autrefois, une réussite dont elle était très fière.
Dimensions du four :
- profondeur utile : 2,35 m ; diamètre : 2,35 m ; hauteur sous voûte : 1,40 m ;
- ouverture : 0,6 m de large sur 0,60 m de haut ;
- épaisseur du bâti : 0,90 m en périphérie ;
- écartement entre les montants droits : 1,05 m ;
- petite table d'autel de 0,35 m de profondeur munie du trou à cendres sur niche de réception ;
- les corbeaux et le linteau sont taillés très sommairement, seul l'entourage de l'ouverture composé de deux gros blocs debout a été finement bouchardé et est remarquable, ils proviennent de la carrière voisine de Kerrous.
(1) Union charte de qualité du patrimoine architectural breton.
Four de Kerho
Ce four était adossé à l'origine, mais le bâtiment initial a disparu. N'ayant pas eu l'occasion de rencontrer le propriétaire, je suppose, vu la présence d'un échafaudage, qu'il a l'intention de le rénover entièrement. Il en a bien besoin, le bâti s'effondre sur la partie droite, mais cet édifice en vaut la peine et il sera magnifique.
C'est un endroit qu'il faudra revoir afin de voir le travail accompli. Dimensions du four :
- profondeur utile : 2,40 m ; diamètre : 2,25 m ; hauteur sous voûte : 1,40 m ;
- ouverture de plein cintre : 0,65 m à la base sur 0,65 m de haut (composée de deux blocs debout) ;
- montants droits très légèrement évasés, écartement : 1,05 m ;
- profondeur de la table d'autel : 0,45 m ;
- linteau de cheminée : 1,50 m de longueur sur 0,45 m de haut (une rainure et un trou bien rond sont dessinés sur ce linteau) ;
- petite niche sous la table d'autel, mais pas de trou à cendres.
Four de Kerrous (adossé)
De la carrière de Kerrous exploitée depuis de nombreuses années furent sans aucun doute extraites les pierres pour la construction du four adossé de cette grande ferme aujourd'hui divisée.
D'après le propriétaire actuel qui me reçoit fort cordialement, l'ancienne écurie à laquelle s'adosse le four abritait un élevage de chevaux fort réputé, comme en témoignent les nombreuses stalles pavées toujours présentes et séparées par des bat-flancs de séparation.
Certains de ces chevaux furent sélectionnés pour la Garde républicaine à Paris, ce qui est tout de même une belle référence. On peut rappeler que les élevages d'Elliant, commune voisine, fournissaient également de montures pour la Garde républicaine.
La façade abritée et toujours solide présente une ouverture de plein cintre composée de deux blocs debout et tête-bêche, taillés selon les règle de l'art, tout comme les deux corbeaux et le linteau très solidement ajustés.
Perdu dans un fouillis de verdure, le bâti, autrefois couvert d'ardoise, est en péril immédiat si personne n'intervient pour le dégager proprement des arbustes envahisseurs. Dimensions du four :
- profondeur utile : 2,20 m ; diamètre : 2,10 m ; hauteur sous voûte : 1,30 m ;
- ouverture de plein cintre : 0,62 m à la base sur 0,62 m de haut (composée de deux pierres debout) ;
- table d'autel encastrée de 0,35 m de profondeur ;
- écartement entre les montants droits : 1,20 m ;
- corbeaux : 1,70 de long sur 0,50 m de haut (curieusement le niveau supérieur des corbeaux s'incline légèrement vers l'intérieur de la hotte de cheminée) ;
- linteau : 1,70 m sur 0,50 m de haut ;
- niveau de la table d'autel par rapport au sol : 0,80 m (sous cette table d'autel, on voit une petite niche, mais pas de trou à cendres).