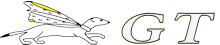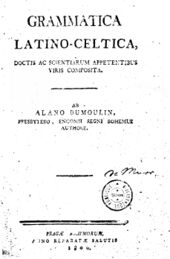Grammaire latine et bretonne de Dumoulin (Prague, 1800)
__NUMBERHEADINGS__
L'idée ici est de présenter une grammaire celtique écrite en latin par un recteur d'Ergué-Gabéric et de relever les passages principaux peuvant contribuer à la connaissance de la langue bretonne en Basse-Bretagne par un curé de campagne à la charnière du 18e et du 19e siècle.
Autres lectures : Modèle:BibDumoulin
Présentation de la grammaire
Préface
- Les 8 pages de la préface
|
Pages F et G il est question de "Torr e Benn da Cesar" (casser la tête de César). Cette phrase qu'Alain Dumoulin affirme être citée dans la Guerre des Gaules de César est une thèse qu'Emile Ernault qualifie d' « exemple notable dont la façon dont il ne faut pas écrire l'histoire des peuples, ni celles des langues » [1] : {{{1}}} Quin imo, longe ante ante Julii Caesaris seculum, in Britannia minori vigebat celtica lingua ; cum enim Julius Caesar quamdam urbem Britanniae minoris nomine Venetensem (gallice Vannes) obsidione teneret, saepe seaudivisse testatur Celtarem clamorem istum : torr e Benn da Cesar ; quae verba significant : frange Caesaris caput ; ea de re ipse Julius Caesar in libro suo de bello gallico sic scribit : quam terribiles sunt Britones, quando dicunt : "torr e Benn da Cesar". Inde Celticam linguam ex Germania in Angliam, ex Anglia in Britanniam minorem, migrasse ante Julii Caesaris seculum, concludere pronum est. |
|width=4% valign=top style="text-align:justify; text-justify:auto"| |width=48% valign=top style="text-align:justify; text-justify:auto"| La traduction de ce texte en français pourrait être :
Revenons plutôt en arrière, avant le siècle de Jules César, la langue celtique était bien en vigueur en petite Bretagne ; en fait lorsque Jules César prit en otage la ville de petite Bretagne nommée Venetensem (en français Vannes), il y eut un cri porté par les celtes : torr e Benn da Cesar ; ce qui signifie littéralement : casser la tête de César ; ce qui conduit Jules César lui-même à écrire dans son livre sur la Guerre des Gaules : qu’ils sont terribles ces Bretons, quand ils crient « torr e Benn da Cesar ». Par conséquent la langue celtique venue des pays germaniques en Angleterre, et d’Angleterre en petite Bretagne, avec les migrations d’avant l’époque de Jules César, évolue encore. |} Ref : « La légende de Torr-è-benn par un prêtre gabéricois » ¤ |}
Grammaire (7 chapitres, 170 pages)
Le plan de la grammaire est le suivant (pour en savoir plus sur les chapitre 1 à 6 cliquer sur le libellé en latin) :
- CAPUT PRIMUM (p 1-13): De litteris Celticis carumque pronuntiatione
- CAPUT SECUNDUM (p 13-35): De adverbiis, de praepositionibus, de conjuctionibus, ...
- CAPUT TERTIUM (p 35-51): De articulis
- CAPUT QUARTUM (p 51-63): De substantivis et adjectivis
- CAPUT QUINTUM (p 63-69): De numeris
- CAPUT SEXTUM (p 69-156): De verbis
- CAPUT SEPTIMUM (p 156-170): Nunc de phraseon constructiones & dedialogis verba faciamus
- Les 15 pages du chapitre 7 sur les expressions courantes
Les annexes
Deux exemples de lettres
Texte breton des deux lettres, la première d'un fils à son père, la seconde d'un père à son fils :
LISER BREZONEC
Us a ur map dhe dad. ______________
Ma za ker !
a bell amzer ne mus recevet kelu ebet us bo pers. Desirut a raffen geseude gazut a iac'h ez oc'h : rac netra ne ra din mui a blijadur evit cleut kelu mad ac'hanoc'h, us ma mam, ac us ma oll gerent : aschuet e mus ar retorig, ac hep dale e allin monet dar vacanzu, abeue dau zeves ez-eo bet e public distribuet ar priziu ; ar boner em us bet da c'honit tri friz. a da veza bet eurunet dirac un assamble a gals tud a sesson : hunne ez eo an oll gonsolation allan rei ser e allin eta, ma zad ker, cauet ar gonsolation da vuschet deoc'h a greiz ma c'halon a gant respect ; en ur c'hortos ur momet quen dus, me a so acc vezo queit a ma vevin.
an unan a tregont
us a vis meurs
er bloa 1800ho mad sentus
Jban NetraLISER ______________
EMUS A UN TAD DE VAP.
Petra glevan ac'hanot, map ingrat, den iauane feneant ? pevar bloas abaue ma emus da gasset dar c'holaish ; bep bloas me em us ranket paea cals argant evidot : us ar mintin betec an noz me da vam, da vreder, da c'hoarrezet, bon dus ranket laburat a c'huisi : esperut a remp e vises bed fur ac babil, ac e visez bed an benor ac ar suten mees evidot, a pepes glac'har evidomp ! da brosessor en dus lavaret din penos ne tus gret sort ebet e pad ar bloas nemt deski pe clevet ar music. nemet guelet ar gomedi, nemet chasq ar goall gompagnunezu gant pere ez-ut e schesseal pe e purmen eped an amzer preferi a roed eta an traou agrabl, antrau memes dangerus dan trau profitable : rac-ze, ezeo es guelet penos ne renti biken servis ebetna da pro, na ha dud : rac-ze ive, me nez-on bet tad dit, na te map din : ne zeu lusfe dirazon ; car ne allan ket supporti da ignorans, da sentantis, na da veschanteri ; due ra da gonvertisso.
- Pages 171 à 174
Une fable
- Pages 175 à 178
Trois prières
- Pages 177 à 184
Un cantique
- Pages 185 à 188
Deux chants profanes
- Pages 189 à 194
Ref : « Une gwerz satirique en breton contre les aérostats en 1800 » ¤ (chant n° 2 sur les aérostats [2] / montgolfières)
Annotations
- ↑ Article d'Emile Ernault "Sur l'histoire du breton", Mémoires de la société d'Histoire et d'archéologie de Bretagne, IX (1928), p 1-2.
- ↑ Aérostat, s.m. : appareil couramment appelé ballon, capable de s'élever et de se maintenir dans les airs, comprenant : un ballon sustentateur gonflé d'un gaz plus léger que l'air, une nacelle et un filet reliant le ballon à la nacelle. On distingue plusieurs catégories d'aérostats : les aérostats captifs ou libres (reliés ou non à la terre par des cordages), les ballons-sondes, les aérostats dirigeables, par ellipse : les dirigeables (TLFi). [Terme] [Lexique]